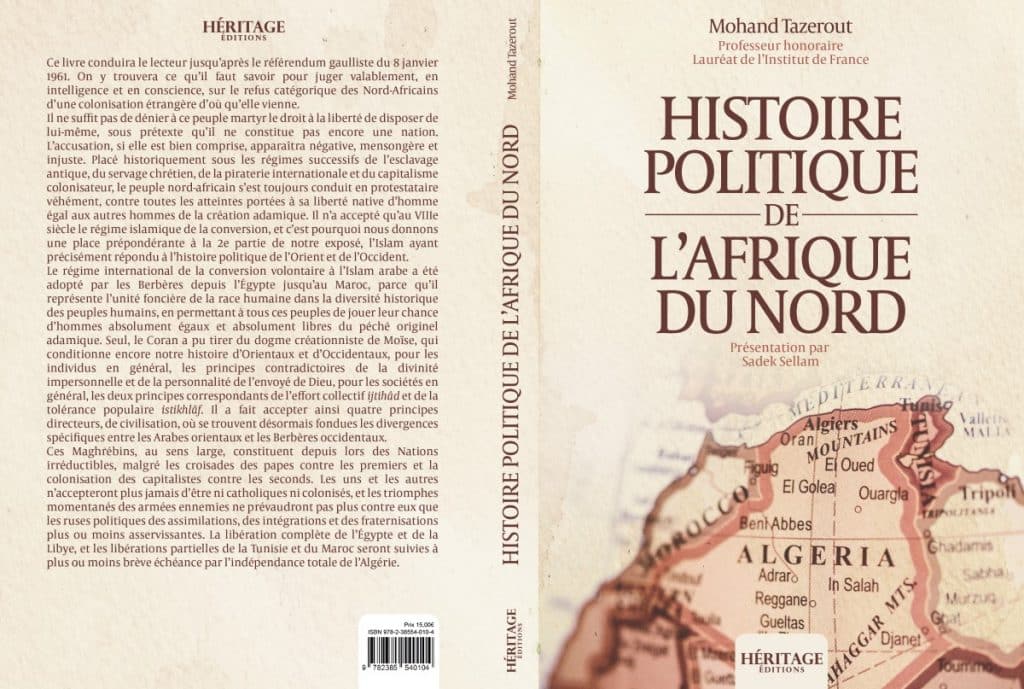Dès la fin des années 20, M. Tazerout (1893-1973) était connu dans les milieux spécialisés comme traducteur de l’allemand au français du célèbre Déclin de l’Occident de Spengler et d’un classique de l’orientalisme, l’Histoire des peuples musulmans de Brockelman. Le lecteur de ces livres savants ne devinait même pas les origines du traducteur parce qu’il ne mettait que l’initiale de son prénom.
On saura un peu plus sur son parcours après la publication d’une longue lettre qu’il a adressée à un député français au sujet de ce qu’il appelait — par euphémisme ou sous-information — les « incidents » du 8 mai 1945 dans le Constantinois.
On y apprend qu’il avait été instituteur adjoint à Theniet-El Had à sa sortie du « Cours normal » de Bouzaréa, qui était réservé aux Indigènes, tandis que les Français et les musulmans naturalisés étaient formés à « l’École normale ». Même cet établissement, que L. Massignon considérait comme un haut lieu de l’égalité entre Européens et musulmans, n’échappait pas aux discriminations négatives du système colonial.
Pour tenter d’y échapper, Tazerout choisit de se naturaliser français en 1914. Il venait d’être mobilisé dans les Tirailleurs où il fait la guerre mondiale. Il est promu au grade de sergent sanitaire juste avant d’être fait prisonnier. En 1917, il se retrouve en Suisse à la suite d’un échange de prisonniers. Le consulat de France à Lausanne, qui lui versait sa solde, l’autorise à s’inscrire à l’université de cette ville où il obtient une licence de latin-allemand. Il obtient ce diplôme comme il avait eu le baccalauréat latin-langues en suivant des cours par correspondance. Dans un rapport élogieux, l’attaché militaire remarque les dispositions du sergent à apprendre les langues étrangères[1]. L’officier note que c’est le tiers colonial qui créait une autre discrimination entre lui et sa femme française, diplômée de l’École normale de Bouzaréa, qui avait stimulé son désir de suivre des études supérieures. Sa situation rappelait celle d’Ahmed Bahloul, instituteur marié à une Française comme lui, et qui est devenu agrégé de physique à cause des frictions créées par le tiers colonial avec son épouse[2].
En 1919, Tazerout s’installe en France et devient professeur d’allemand dans le secondaire. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il réalise une étude pour la « Recherche scientifique » sur les centres de recherche et de documentation en Allemagne[3]. C’est ce séjour prolongé en Allemagne qui lui fournira la matière pour son livre sur les Éducateurs sociaux de l’Allemagne. Sa germanophilie a éveillé des soupçons de sympathie pour le IIIe Reich. Mais on sait maintenant qu’il prenait le risque de distribuer les tracts de la résistance à Paris quand une bonne partie de la bourgeoisie parisienne cherchait à se donner bonne conscience en disant des Allemands : « Y a pas à dire, ils sont corrects ! »
En 1945, il est professeur au collège Chaptal à Paris où il a également la fonction de directeur d’Études. Quand il a été lauréat à l’Institut de France dans les années 50, il était professeur au lycée Charlemagne. Il se fera connaître en 1953 par sa série de plusieurs volumes intitulée « au Congrès des civilisés[4] » où il donne la parole aux représentants de chacune des grandes civilisations classées selon la typologie de Spengler qu’il avait traduit dans les années 20.
Jusqu’à l’installation de la France dans la guerre totale en Algérie, Tazerout semblait s’en tenir à une attitude assimilationniste désapprouvant des injustices qui, lui semblait-il, avaient eu leurs équivalents en France et auxquelles il lui semblait possible de remédier par une application du principe d’égalité aux « indigènes ». Il n’était pas mécontent de sa situation et il supposait qu’une France mieux gouvernée finirait par donner à ses coreligionnaires méritants la possibilité de bénéficier de promotions sociales comparables.
Il s’intéressait aux « affaires algériennes » « en tant que natif de ce pays, en tant que citoyen français », mais aussi « en tant que sociologue désintéressé des politiques et des idéologies internationales[5]… »
Mais alors que la spécificité de « la situation coloniale » était soulignée par des précurseurs comme Malek Bennabi[6] et Georges Balandier[7], cet érudit continuait à envisager les malaises en Algérie du seul point de vue de la question sociale.
« Toutes les injustices perpétrées en Algérie l’étaient déjà antérieurement en France, d’instinct et sans aucun machiavélisme d’un genre nouveau, d’un genre colonial. Les musulmans eux-mêmes n’en furent pas dupes, puisqu’ils s’infiltrèrent progressivement dans les postes administratifs dès la chute d’Abdelkader… »
La France avait une « politique anarchique, certes, du point de vue de la justice sociale, mais qui réservait la possibilité d’une assimilation des indigènes, comme elle réservera à la bourgeoisie métropolitaine sa réconciliation avec l’Église et avec la noblesse françaises, également dépossédées ».
Il justifiait son optimisme en rappelant que « la France et Algérie sont entrées dans le second siècle de leur croisement économique rendu indispensable par la conquête et la fixation de deux races différentes sur le même sol nourricier ». Ce « croisement fatal » n’a jamais été « interrompu, ni par les révoltes locales d’Algériens, dont aucune ne fut assez forte pour exclure les Français de leur droit de souveraineté sur la population conquise, ni par les frictions des impérialismes étrangers, dont aucun aussi n’a pu mettre en doute un état de fait conforme aux habitudes et au droit international public et privé ». Si bien que « les rapports de colonisateur à colonisé sont devenus en Algérie une affaire de politique intérieure ». Du reste, « la division en trois départements civils n’eût pas été possible si la population musulmane avait continué à se réclamer exclusivement de l’Islam… »
Le facteur religieux lui paraissait secondaire. Sans doute en raison de ses origines maraboutiques, il s’en tenait à une laïcité respectueuse des croyances qu’il ne mettait néanmoins pas au centre de ses préoccupations.
Sa position rappelait en partie celle des « Jeunes Algériens », avec moins d’insistance chez lui sur l’essence politique des problèmes coloniaux. Son assimilationnisme lui faisait accepter le fait accompli colonial. En tant qu’enseignant, il croyait aux possibilités de promotion par l’école, comme les instituteurs de la « Voix des Humbles ». Il préconisait une politique scolaire ambitieuse. Il recommandait notamment l’apprentissage de l’arabe et du berbère aux enseignants français affectés dans les régions reculées. Cela rappelait la proposition faite à l’Assemblée nationale en 1897 par le Dr Grenier, le député musulman de Pontarlier, de multiplier le nombre de médecins de campagne en Algérie et de les obliger de rédiger les ordonnances en… arabe.
La nomination en 1948 au poste de Gouverneur général à Alger de Naegelen, ministre socialiste de l’Éducation nationale qui croyait à la promotion par l’école, devait le conforter dans son optimisme et sa dédramatisation des problèmes politiques.
Il ne savait pas que la mission assignée à l’institution scolaire française en Afrique du Nord par l’inspecteur général d’arabe W. Marçais consistait à « former des sujets et non des citoyens ».
Il n’était pas anti-islamique comme Me Belkacem Ibazizen, qui s’était converti au christianisme. Il n’y avait pas chez lui non plus les outrances provocatrices de Hesnay Lahmek, l’auteur des Lettres algériennes dont la publication à l’occasion du Centenaire avait contribué à envenimer les relations entre les dirigeants de l’AEMNAF et Massignon, qui n’avait pas encore rompu totalement avec le christianisme colonial de Foucauld.
Mais Mohand Tazerout est revenu de l’illusion assimilationniste, sans doute sous l’effet de la « guerre totale » menée par la France en Algérie à partir des états d’urgence locaux d’avril 1955. Il y avait en effet de quoi ébranler sa foi dans les bienfaits du « modèle français d’intégration ». Cette perte de foi a coïncidé avec la proclamation par le Gouverneur général Jacques Soustelle de la politique d’« intégration » dont le glas a sonné après la publication, en septembre 1955, de « l’appel des 61 » :
« Les troubles actuels sont d’ordre politique. La politique d’intégration, qui n’a jamais été appliquée, est actuellement dépassée. La majorité du peuple veut une Nation algérienne. Nous créerons un comité permanent de coordination de l’action des élus à tous les échelons et qui aura pour tâche de suivre l’évolution de la situation politique. Nous quitterons la salle des séances pour manifester ainsi notre opposition ».
C’est à ce moment-là qu’Alain de Sérigny daignait reconnaître l’existence en Algérie de « problèmes économiques et sociaux », mais, entonnant « l’antienne chantée de Bugeaud à Lyautey qu’on ne doit pas faire de politique en Afrique du Nord[8] », s’en prenait durement à ceux qui parlaient de « problèmes politiques ».
Les signataires de cet appel étaient des « modérés » qui avaient cru, comme Tazerout, à une réforme du système colonial. La prise de conscience de ces « évolués », que Soustelle voulait regrouper dans une « Troisième force », résultait en partie du recours à des méthodes répressives plus brutales que celles des débuts de la conquête par des gouvernements qui croyaient à une solution militaire. En 1956, un seul bombardement a rasé 25 mechtas et tué près d’un millier de personnes en Kabylie, la région natale de Tazerout[9]…
Cette répression aveugle était accompagnée d’une « Action psychologique » de grande ampleur qui empruntait ses thèmes aux vieilles idéologies coloniales niant l’existence d’un peuple algérien et ajustant l’écriture de l’histoire du pays aux besoins de cette négation. En dehors d’honorables exceptions, les journalistes et les commentateurs relayaient ces discours idéologiques en donnant à la propagande des allures d’impartialité. La dépendance de la presse des Deuxième et Cinquième bureaux du XIXe Corps d’Armée, rebaptisé Xe Région Militaire, contribua ainsi à faire de la vérité la première grande victime de la guerre. La grande importance accordée au renseignement a perverti une partie de la presse. C’est ce qui explique que les « Libres Opinions » proposées au Monde par M. Arkoun en 1956-1957 sont conservées, non pas dans les archives de Beuve-Méry, mais dans celles du directeur des affaires politiques du Gouvernement général. Non seulement le rédacteur en chef du Monde ne publiait pas ces articles favorables à l’indépendance et au renouvellement des études islamiques, mais il les a communiqués à l’entourage de Lacoste dont l’intérêt pour l’évolution des intellectuels algériens servait la politique de « pacification ». Cette connivence secrète de la presse et de l’Armée n’avait rien d’étonnant puisque le général Massu a été jusqu’à « prêter » à L’Écho d’Alger son chef d’État-Major, le capitaine Marion.
Ces pratiques venaient rappeler à ceux qui l’ignoraient la nature totalitaire du colonialisme et amenaient des chercheurs apparemment neutres à révéler leur vrai visage. C’est ainsi que l’ethnographe P. Servier décida de se rendre plus utile en mettant en place les premières harkas. Quant à R. Montagne, dont toute la démarche était une illustration de la formule de Disraéli — « l’Orient est une carrière » —, il mettait sa science au service des politiques répressives en imputant les désastres coloniaux à un grand coupable : « l’Islam, ce levain qui fait lever la pâte du nationalisme algérien contre la France[10] ». Ce « sociologue de service » (selon le jugement de Berque) avait montré sa singulière « prescience » en glosant sur « la quiétude de l’Algérie » dans une conférence qui est restée célèbre parce qu’elle a été prononcée en 1953 quelques mois seulement avant le 1er novembre 1954. Plus discrètement, Roger Le Tourneau faisait bénéficier de son savoir islamologique le Deuxième Bureau en lui expliquant que la conférence de Bandoeng d’avril 1955 était aussi dangereuse que les Congrès musulmans du Caire (1925), de La Mecque (1926) et de Jérusalem (1931). L’année suivante, Marcel Colombe enfilera la tenue léopard pour sauter avec la 10e Division parachutiste sur Port-Saïd, comme traducteur. Ce recours aux chercheurs continuait jusqu’en 1961 quand un jeune agrégé d’arabe a été « approché » dès son arrivée à l’Institut français de Damas par le responsable du SDECE à l’ambassade de France pour lui demander de « collaborer ». Mesurant depuis longtemps la gravité de la crise de confiance provoquée par la mise de l’enseignement au service du renseignement, L. Massignon avait fait prendre à ce jeune chercheur un engagement de « ne pas trahir la confiance de nos amis arabes[11] ». Quant à l’ambassade de France à Tunis, elle n’hésitait pas à recourir à des religieux chrétiens arabisants pour la renseigner sur le FLN…
Cette collusion du « Sociologue et du Commissaire », que dénonçait C. Bourdet, rendait très difficile pour les intellectuels musulmans toute « coopération entre camarades de travail intellectuel » dans un esprit comparable à la réelle fraternité d’armes de la Première Guerre mondiale qui semble avoir déterminé les choix de M. Tazerout.
La guerre d’Algérie a dévoyé bon nombre de journalistes et perverti une partie de la recherche universitaire, comme elle a fait de l’institution judiciaire une « drôle de justice ». Ces dérives autorisaient des parallèles entre la manipulation de la vérité politique par crainte de perdre un territoire, et l’appropriation de l’histoire du pays colonisé sous l’effet de l’euphorie de la conquête et du triomphalisme du Centenaire.
Les administrations coloniales utilisaient des « supplétifs de traducteurs et de conseillers », qui maintenaient de « fortes traditions, généralement en retard de quelques décennies sur la situation présente[12] ». Ces traditions étaient puisées dans une « vulgate » codifiée par les premiers idéologues du colonialisme qui envisageaient toute l’histoire du pays en fonction des intérêts supérieurs de la colonisation.
Celle-ci est, selon Leroy-Beaulieu, « la force d’expansion d’un peuple ; c’est son pouvoir de reproduction, c’est sa croissance et sa multiplication dans l’espace ; c’est la sujétion de l’univers ou d’une grande partie de l’univers à la langue, aux usages, aux idées et aux lois de ce peuple[13] ».
En raison du consensus autour de cet objectif, « l’impérialisme politique gouverne un domaine entier des études, de l’imagination et des institutions savantes — de telle sorte que c’est une impossibilité intellectuelle et historique de l’éviter ». Et « la guilde des orientalistes a été historiquement la complice du pouvoir impérial, et ce serait faire preuve d’une bienveillance béate que de soutenir que cette complicité est sans incidence[14] ». Car dans l’ordre colonial, avec ses « institutions, un vocabulaire, un enseignement, une imagerie, des doctrines et même des bureaucraties coloniales et des styles coloniaux », « la politique pèse sur la production littéraire, les théories sociales et l’écriture de l’histoire ».
- Tazerout en était d’autant plus convaincu en 1961 qu’il s’était donné la peine de consacrer des années à passer en revue les sources bibliographiques du livre de référence que G. Marçais avait consacré à « la Berbérie musulmane et l’Orient ». Ces lectures poudreuses lui ont fait découvrir la part des présupposés idéologiques de l’auteur dans la sélection des faits, et dans leur interprétation qui n’allait pas sans déductions parfois hâtives ni extrapolations hasardeuses.
Le poids de l’idéologie dans l’écriture de l’histoire a conduit à mêler à la « vérité historique » un certain nombre de mythes pour les besoins de la domination coloniale. C’est ainsi que l’insistance sur les particularismes kabyles a fourni un des plus fameux mythes fondateurs à la « politique berbère ».
« Les Berbères d’Algérie, envisagés pratiquement sous le seul aspect des montagnards de Petite et de Grande Kabylie, étaient tenus pour plus assimilables parce que, disait-on, “superficiellement islamisés et ennemis nés des Arabes”. Le particularisme kabyle, grossi par les effets d’une littérature polémique, donna bientôt naissance à un véritable mythe kabyle. Le peuple kabyle était censé descendre des Gaulois (!), des Romains, des Berbères chrétiens de l’époque romaine, voire des Vandales ! Certains ne désespéraient donc pas de lui rendre sa “foi chrétienne”, et c’est ce qui explique les tentatives de conversion menées par Mgr Lavigerie. Elles échouèrent totalement[15]. »
Cette « politique berbère » était préconisée par Tocqueville qui, dès 1837, estimait que « si le pays Kabyle nous était fermé, l’âme des Kabyles nous est ouverte et il ne nous est pas impossible d’y pénétrer[16] ».
En 1847, Daumas et Fabar faisaient, dans La Grande Kabylie, une description mythique de la « race kabyle » en partie d’origine germanique » et toujours marquée par son imprégnation chrétienne. C’est une « Suisse sauvage composée de tribus indépendantes dont la fédération n’a pas même de caractère permanent. La conclusion de cette « Somme kabyle » jetait les bases d’une politique berbère : « Maintien des formes républicaines de la tribu, délégation de l’exercice du pouvoir à ses amines, emploi judicieux des çoffs et des grandes familles, respect aux lois antiques du pays, à ces qanouns traditionnels, qui d’ailleurs ne froissent en rien nos grands principes de droit public[17]. »
Le colonel Carette proposait de « faire du Kabyle l’auxiliaire le plus intelligent de nos entreprises ». Pellissier de Reynaud et le baron Aucapitaine plaidaient pour la « fusion » de la race kabyle et de la race française et estimaient que « dans 100 ans, les Kabyles seront français ! »
En 1871, le sénateur d’Oran Pomel pensait que « les Berbères d’origine celte ont été sacrifiés aux Arabes par la politique du Royaume arabe… ce sera à la colonisation de les amender, cependant que les Arabes devront être refoulés vers le Sahara[18]… »
Paul Bert considérait le « Kabyle » comme « ennemi », mais recommandait le rapprochement avec cet « homme positif face au cléricalisme musulman ».
Les Berbères, ces descendants des anciens Romains chrétiens, « musulmans aussi peu que possible », montraient « les plus heureuses dispositions pour un retour complet au christianisme[19] ».
Warnier prophétisait que l’avenir de l’Algérie n’appartenait ni « à la juxtaposition des tribus arabes », ni à l’islamisme, mais bien « au christianisme et à l’alliance franco-kabyle… »
Selon Ageron, « malgré la politique d’assimilation et nos traditions administratives d’uniformisation, l’administration algérienne pratiqua discrètement en matière indigène la politique du « divide ut imperes ». La Kabylie, « Auvergne d’Afrique », devait, contradictoirement, recevoir nos lois et conserver ses coutumes. Les juges musulmans furent supprimés ou réduits au rang de notaires, les écoles coraniques fermées, l’obligation scolaire imposée dans les écoles françaises. Pourtant, malgré certaines tentatives curieuses de francisation accélérée, on se préoccupa surtout de défendre les qanouns kabyles contre la charia, de conserver au pays ses chefs particuliers, les amîn (oumana), et son système d’impôts traditionnels. On toléra les djemaas (assemblées) de villages, supprimées en droit ; on favorisa l’usage des dialectes kabyles. En 1898, les Kabyles reçurent une représentation spéciale aux délégations financières « pour que les deux peuples d’Algérie ne s’habituent pas au contact l’un de l’autre ». En fait, cette politique de division impériale fut impuissante : avec le développement des communications, l’arabisation des cantons kabyles progressa ; la francisation ne détacha que quelques individus avant la grande émigration des ouvriers kabyles en Métropole. L’échec de cette politique devait alimenter jusqu’à nos jours de constantes récriminations contre l’Administration, accusée, bien à tort, « d’avoir islamisé et arabisé le peuple kabyle ».
L’engouement pour la « nationalité kabyle », les plaidoyers pour une « alliance franco-kabyle », et la nécessité de « kabyliser l’Algérie » visaient surtout à combattre le projet de « royaume arabe » de Napoléon III.
On sait maintenant que cette politique comportait un volet oriental prévoyant une « alliance franco-wahhabite[20] », et même l’envoi de Pères blancs pour christianiser les Bédouins du Nejd, dont le sentiment religieux était jugé superficiel. Pour s’opposer à cette politique, les défenseurs de la colonisation de peuplement mirent à contribution les missionnaires et ne cessèrent de proclamer les droits de la « nationalité berbère » et la valeur de ses institutions politiques. Car, selon leur lecture de l’histoire, la « tribu berbère descendait du municipe romain » et les villages kabyles auraient conservé intacte l’organisation municipale romaine.
C’est ainsi qu’entre 1857 et 1870 fut mise en place une « organisation kabyle » dont le système électoral reposait sur des çoffs et permit l’élection annuelle d’une multitude de petits chefs, les amîn coiffés par amîn al-umanâ’. Les mahkama de cadis furent supprimées pour accorder le pouvoir judiciaire aux djemaas, « par le seul fait que la loi qu’elles appliquent n’est pas la loi musulmane » (colonel Hanoteau), mais la coutume kabyle, codifiée par des officiers français, en s’arrangeant pour l’unifier et l’expurger de ses prescriptions les plus barbares. Devenu général, Hanoteau, aidé par le conseiller Letourneux, prépara et publia en trois volumes, La Kabylie et les coutumes kabyles. Dans la correspondance privée Hanoteau-Letourneux, le but avoué était de « faire appliquer le droit coutumier kabyle par des juges français ». Mais le projet n’aboutit pas : colons et députés préfèrent établir directement le Code civil français dans cette « Auvergne de l’Afrique du Nord, toute prête à l’assimilation ».
Dans ce climat d’arabophobie de l’opinion coloniale, le savant directeur de l’École des Lettres d’Alger, Émile Masqueray, proposait de « libérer les Berbères refoulés par les Arabes et exploités par les Turcs », pour combattre « l’islamisme, notre éternel ennemi ».
Pour ce théoricien colonial, « les lois kabyles aident singulièrement notre politique parce qu’elles diffèrent de la loi musulmane. Une loi kabyle est pour nous infiniment précieuse : plus nous en usons, plus le fossé se creuse entre les musulmans arabes et leurs vaincus généreux ».
Cette obstination conduisit aux tentatives de faire renaître le « système kabyle » entre 1881 et 1885. En 1882, la connaissance du kabyle rapportait des primes substantielles pour les fonctionnaires français. En 1885, une chaire de dialectes berbères à l’École des Lettres d’Alger est confiée à un notable francophile Hachemi Ibn Si Lounis. Le brevet de langue kabyle rapportait une prime annuelle de 300 F, et un diplôme plus élevé de 500 F. « Mais l’enseignement officiel du kabyle — du dialecte zouaoua pour mieux dire — ne tarda pas à tomber en discrédit ».
Ce que les gambettistes approuvaient en tant qu’expérience de « politique positiviste » était défendue avec acharnement par Camille Sabatier, ex-juge devenu administrateur de commune mixte à Tizi-Ouzou : « Chez le Kabyle, point de religion…Ses qanouns sont la négation la plus énergique des principes de l’Islam ».
Avec Renoux, administrateur du Djurdjura, Sabatier combattit les confréries, interdit les quêtes religieuses, supprima les écoles coraniques, ferma les zaouïas, entendant faciliter ainsi la tâche de l’école laïque française. Cette politique qui fit de l’instituteur le « conquérant de la Kabylie » s’accompagnait d’une surveillance tracassière des dernières zaouïas…
En dépit des « discriminations positives », sur les plans fiscal et scolaire notamment, qui accompagnaient cette « politique berbère », ses résultats furent en deçà du zèle assimilationniste et anti-islamique des tenants du « mythe kabyle » : il y n’y eut que 30 naturalisations en 4 ans parmi les ouvriers agricoles…
Devenu député radical en 1885 de la circonscription de Tlemcen-Sidi Bel Abbès, Sabatier proposa un Conseil colonial avec deux conseils consultatifs indigènes, l’un arabe, l’autre kabyle. Les délégués des « démocrates kabyles « seraient élus ; tandis que les délégués arabes seraient nommés pour éviter de renforcer par l’élection « l’aristocratie arabe ».
« Divide ut imperes ? Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas prévenir une union qui ne pourrait se faire que contre la France ?» C’est en ces termes que Sabatier a justifié le double collège en 1891. Le projet constitutionnel ne fut pas pris en considération en 1889. Mais Sabatier a eu une éclatante revanche en 1898, lorsqu’il réussit à imposer son système sous le nom de Délégations financières. Soutenue par l’ampleur du mythe kabyle, la politique qui s’en inspirait, freinée après 1885, n’avait donc pas disparu.
Non réélu, Sabatier devient conseiller en 1898 du Gouverneur général Laferrière, nommé par le ministère radical Brisson. Il le persuade d’appliquer la « politique des races » mise à la mode par Gallieni : « … il y a des haines et des rivalités qu’il faut savoir démêler et utiliser à notre profit en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour vaincre les autres ». Laferrière se borna à créer dans les nouvelles délégations financières une délégation kabyle et une délégation arabe pour assurer « la libre expression à nos deux grandes races sujettes[21] ».
Le journal Le Temps approuva cette politique tendant à « … accroître les différences qui séparaient les Kabyles des autres indigènes. Ce n’est pas seulement parce que plus une population est divisée, plus elle est facile à gouverner, c’est surtout parce que les Kabyles ont des qualités particulières qui doivent en faire des auxiliaires précieux de la colonisation ».
Ces errements provoquèrent des réactions de type raciste, hostiles aussi bien aux Arabes qu’aux Kabyles.
En 1893, dans les Études algériennes, un auteur ridiculisait ceux qui avaient parlé de « Celtes de Kabylie » ou célébré des « vestiges frustes décorés pompeusement du nom d’institutions démocratiques. L’auteur conclut qu’on ne pouvait pas plus faire confiance aux Berbères qu’aux Arabes. On redoutait qu’en s’intéressant trop aux Kabyles, la France ne parvînt à « donner au peuple berbère une conscience historique ». « Alors, rien ne l’empêcherait de nous jeter à la mer », craignait ce « réaliste ».
Malgré ces réactions, les clichés du mythe kabyle refleurissaient en France avec les ouvrages du capitaine Piquet, de B. Luc et du capitaine Le Glay, et surtout avec ce qu’on croyait savoir de la politique pratiquée au Maroc[22]. Les hommes de Gauche incriminaient le conservatisme de la direction des Affaires indigènes d’Alger trop encline à voir dans « les Kabyles, plus facilement assimilables, d’immuables Berbères ».
À Alger, au contraire, la berbérophilie était classée par un sous-directeur du service des Affaires indigènes parmi d’autres « maladies de la pensée politique française[23] ».
La culture d’un « assimilé » originaire de Kabylie comme Tazerout devait être nourrie en bonne partie par l’abondante littérature destinée à forger le « mythe kabyle ». Le choc provoqué par les échos de la répression menée en Algérie et le refus de la propagande qui actualisait les vieilles idéologies coloniales justifièrent chez lui des remises en causes radicales. Sa démarche n’était pas sans rappeler cette définition de la « conscience historique » donnée par Gramci :
« Le point de départ de l’élaboration critique est la conscience de ce qui est réellement, c’est-à-dire un “connais-toi toi-même” en tant que produit du processus historique qui s’est déroulé jusqu’ici et qui a laissé en toi-même une infinité de traces, reçues sans bénéfice d’inventaire. C’est un tel inventaire qu’il faut faire pour commencer[24]. »
L’exercice auquel s’est livré cet autodidacte, qui n’avait suivi que les cours de l’école primaire et ceux du « Cours normal » de Bouzaréa pour « indigènes », l’a amené à conclure à l’existence d’un être collectif appelé « Nation nord-africaine ». Il a voulu apporter sa contribution à l’étude de l’histoire de cette entité qui a été rendue, selon lui, homogène par l’Islam. Il s’est proposé d’expurger cette histoire des élaborations mythiques dictées par l’intérêt colonial.
Dans sa bibliographie, il décide de ne retenir que les sources arabes comme Abû al Arab : Tabaqat des savants d’Ifriqiya, At Tenessi : Histoire des rois de Tlemcen, Ibn Idhari : Bayan al Maghrib, Mouqaddassi : Description de l’Occident musulman, Yahya Ibn Khaldûn : Histoire des Béni Abd al Wad. Il fait exception pour quelques auteurs latins et allemands et deux auteurs français atypiques, Egretaut et Habart. Il cite « l’historien Haïdar Bammate », pour Visages de l’Islam, mais omet L’Histoire de l’Afrique du Nord de C. A. Julien, qui le lui rend bien : dans la copieuse bibliographie ajoutée dans la réédition en 1972 de L’Afrique du Nord en marche, Tazerout n’est cité pour aucun de ses livres. On peut supposer que la fin de l’illusion assimilationniste et la réaction de rejet qui l’a suivie ont amené le germanisant voulant faire œuvre d’historien à déplorer les insuffisances de la social-démocratie concernant les problèmes coloniaux.
Il passe en revue les principales périodes de l’histoire de l’Afrique du Nord depuis l’Antiquité dans le but de démentir ceux qui dénient au peuple nord-africain « le droit à la liberté de disposer de lui-même » sous prétexte que « ce peuple ne constituerait pas une nation ».
Contre « l’esclavage antique », le « servage chrétien », le « capitalisme colonisateur », le « peuple nord-africain s’est toujours conduit en protestataire véhément contre toutes les atteintes portées à sa liberté native à sa liberté d’homme égal aux autres hommes de la création adamique. Déplorant que l’écriture de l’histoire de la période anté-islamique ait été le fait d’historiens étrangers, il lui consacre une synthèse concise avant de s’appesantir sur l’Islam qui a « répondu à l’histoire politique de l’Orient et de l’Occident ».
« Un seul peuple étranger, les Arabes de l’Islam, a pu l’assimiler en s’assimilant lui-même à elle de 640 à 1830 ». Car le « régime international de la conversion volontaire à l’Islam arabe a été adopté par les Berbères depuis l’Égypte jusqu’au Maroc, parce qu’il représente l’unité foncière de la race humaine dans la diversité historique des peuples humains, en permettant à tous ces peuples de jouer leur chance d’hommes absolument égaux et absolument libres du péché originel adamique ».
Il arrive à la conclusion que « les Arabes entreprirent la conversion pacifique de ces Berbères, à la conscience et à l’intelligence du Coran, qui les libérera justement des chaînes de la colonisation traditionnelle pesant depuis un millénaire sur eux… » « La doctrine coranique était, psychologiquement et sociologiquement, une libération religieuse du péché adamique qui terrorisait alors les chrétiens et même les juifs ». C’est pourquoi « les cinq pays qui composent l’Afrique du Nord entière ont réalisé leur unité politique et religieuse depuis l’Islam et par l’Islam… »
La période coloniale lui paraît caractérisée par « une paralysie morale » qui « s’accroissait par la corruption administrative des fonctionnaires : administrateurs de communes mixtes, délégués financiers, interprètes judiciaires et cadis, caïds, aghas, bachaghas, tous destinés par vocation à “faire suer le burnous”, à promouvoir le mouchardage et à terroriser la population musulmane, qui demeurait aussi réfractaire à la naturalisation politique individuelle qu’à la conversion au christianisme ».
Il regrette que Crémieux ait « libéré en masse politiquement les seuls juifs algériens de l’indigénat, qui pesait aussi sur eux ».
Le colonialisme était également à l’origine d’une « paralysie intellectuelle » provenant « depuis 1830 de la fermeture générale des écoles arabes, non compensée par l’ouverture équivalente d’établissements français pour tous les enfants d’âge scolaire ».
« En 1881, pour 275. 800 familles recensées dans les 4 cercles de Dellys, Dra el Mizan, Tizi Ouzou et Fort National, Hanoteaux et Letourneux nous apprennent qu’il n’existait que 4 écoles primaires françaises ; alors que le qanoun du village de Cherfa, par exemple, faisait au père l’obligation stricte, sous peine d’amende, d’apprendre à lire à son fils « un an au plus tard après que l’enfant a changé de dents ». En revanche, « la loi française du 25. 6. 1890 renforçait pour 7 ans au moins, le code répressif de l’indigénat qui s’appliquera encore jusqu’après 1914-1918 ».
Il s’appesantit sur « l’étape républicaine décisive, celle de la dépersonnalisation de l’indigène, après sa défaite militaire et l’expropriation des biens par les seigneurs de la colonisation.
On avait auparavant engagé cet homme impersonnel à titre de mercenaire, dans les bataillons de tirailleurs ou les escadrons de spahis et de goumiers, afin de le lancer comme chair à canon dans les conquêtes successives de la Tunisie, de l’Indochine, de Madagascar et du Maroc, et il y apprit à devenir “sous-officier indigène” au bout de 15 à 20 ans de service ».
Son jugement sur ce qu’il avait vécu devient implacable et précis :
« En 1914, on le (l’indigène) mobilisa de force et au même titre contre l’Allemagne impériale, en lui ouvrant exceptionnellement la carrière subalterne “d’officier indigène”, après l’avoir préalablement soumis à la loi générale du recrutement, qui lui faisait miroiter l’acquisition prochaine de la citoyenneté française, sans naturalisation ni conversion forcées.
Mais la fin de la guerre et surtout la célébration tapageuse, en 1930, du maudit “centenaire de l’Algérie”, lui dessillèrent enfin les yeux, en lui montrant qu’il avait simplement et faussement rêvé d’une impossible “assimilation” de l’Algérien au Français, tandis que ses maîtres entendaient au contraire achever coûte que coûte la dépersonnalisation si bien commencée. »
Au sujet du 8 mai 1945, il renonce à son jugement complaisant de sa lettre à Tubert et retient le chiffre de 45 000 tués. Il dénonce « l’institution rétrograde ou dégradante du double régime électoral ».
Pour lui, le 1er novembre 1954 a pu avoir lieu quand « les électeurs bernés du deuxième collège se retirèrent en masse sur les montagnes abruptes des Aurès, dont ils firent le mont Aventin de la nouvelle plèbe algérienne. Leurs élus les y suivirent peu à peu, à mesure qu’ils prenaient conscience de leur parfaite inutilité. Tous ensembles, ils formèrent un front de lutte de plus en plus serré, le FLN, en laissant légiférer dans le vide les élus égarés et privilégiés du 1er collège… »
La France a réagi par une répression avec « des avions et des munitions » qu’elle « ne possédait même pas, et qu’elle réclame aux États-Unis comme à l’Allemagne d’Adenauer, en échange des pétroles algériens et des camps d’instruction d’aviateurs allemands, à Mourmelon ou ailleurs ». « Le ministre Lacoste installé à demeure à Alger avec Massu pour la direction suprême des ratissages, des bombardements, des déportations dans les camps de la mort, et pour la suspicion générale de tout un peuple sur lequel on exerce impunément l’assassinat politique ou policier, la torture judiciaire et militaire, la piraterie navale et aérienne, parce qu’il est d’avance déclaré « hors la loi » par le Parlement de Paris… »
C’est le signe d’une « volonté colonialiste d’exterminer le peuple algérien, après l’avoir ruiné et dépersonnalisé… »
On voit qu’il n’avait aucune hésitation à recourir à la terminologie habituellement réservée à caractériser les méthodes de l’Allemagne nazie pour qualifier la répression menée par la France en Algérie.
Il n’était pas dupe des élections de 1958 qui permirent l’arrivée d’Algérie au Parlement de « 46 députés achetés, au lieu de 15 ». « Les députés musulmans n’ont aucun rôle politique à jouer… ne possèdent aucune compétence pour discuter des affaires d’une métropole où ils ne sont pas citoyens, et qui ne sait pas elle-même si elle veut les assimiler, les associer ou les exclure de ses préoccupations immédiates ».
« Qu’est-ce donc une élection où les candidats d’avance suspects sont triés sur le volet par le gouvernement, et leurs électeurs conduits par bandes devant les urnes par un gendarme, un caïd ou un harki, qui leur distribuent des bulletins, tout préparés, même s’ils désirent s’abstenir de voter ?
Grâce au combat du peuple algérien, « non seulement la “personnalité algérienne” cesse de dépendre désormais d’un gouvernement gaulliste et de sa poignée de “Béni-oui-oui” autour d’une magique “table ronde”, mais encore elle devient génératrice de la nationalité algérienne de demain, qui comprendra tout le FLN et son armée de libération, tous les communistes clandestins d’Algérie et la majorité des partisans de la fameuse “gauche française”, à peine tolérée aujourd’hui dans son propre pays… »
Il était persuadé que « comme les chrétiens d’autrefois eurent triomphé des persécutions impériales de Rome ou de Byzance, le FLN algérien peut défier aujourd’hui les ministres socialistes et les généraux gaullistes de l’Algérie, malgré la torture judiciaire, les armées, sans commune mesure, et la perversion générale des consciences par le mensonge impudent du “citoyen à part entière” et de la “fraternisation” ».
« La solution du problème colonial dépendait déjà beaucoup moins de la technique des bombardements par canonnières, du XVe au XIXe siècles, que de la terreur qu’avaient les colonisés de cette technique nouvelle pour eux. Mais aujourd’hui tous les colonisés qui ont expérimenté comme les Algériens les effets de cette technique de mort ont cessé d’avoir peur des avions bombardiers ; ils savent que l’arme atomique elle-même n’épargnera pas moins la victime que le victimaire. »
Cette solution passera par le GPRA et son ALN qui « ne sont pas composés de carriéristes qui cherchent à obtenir des avantages personnels, mais des patriotes convaincus et intègres qui se battent pour la liberté ou la mort… »
Aux objections sur les méthodes des combattants algériens, il répond que « le FLN est acculé à la nécessité de se défendre depuis sept ans contre l’extermination lente » et qu’il est « toujours vain d’accuser les autres des crimes qu’on commet soi-même au centuple, en particulier d’un coup de couteau contre un bombardement suivi de ratissage… », sans parler des « camps de concentration ». Il retient déjà le chiffre d’un million de morts et juge « l’extermination inéluctable tant que subsisteront les rapports de colonisation ».
Il souligne la vanité de « l’Algérie algérienne » en étant convaincu que « le GPRA et l’ALN ne veulent absolument pas entendre parler d’une “assimilation” dépassée, que la France n’avait jamais offerte loyalement, ni d’une “intégration” que proposaient encore le 26. 9. 1955 Faure et le Gouverneur général Soustelle à l’Assemblée algérienne ».
Au délégué général P. Delouvrier qui, pour exagérer les succès du Plan de Constantine, déclarait que l’Algérie cessait d’être un « champ de bataille » pour devenir « un chantier », il rappelle que « les champs de bataille restent toujours des charniers… »
Se souvenant de son intérêt pour la Révolution d’octobre qui l’avait amené jusqu’à Moscou en 1917, il n’omet pas de déplorer « l’anticommunisme maladif et stérile ».
Son analyse circonstanciée de la situation algérienne ne le détourne pas de l’histoire récente de la Libye, de la Tunisie et du Maroc sur lesquels il disposait d’une information précise.
Il récusait la bienveillance des commentateurs pour Lyautey qui « n’avait rien à envier aux Gouverneurs généraux d’Algérie… la botte française pesait d’un poids égal sur les trois peuples frères du Maghreb ».
Dans ce livre dense et clair, l’auteur montre l’étendue de sa culture historique aussi bien que la perspicacité de ses jugements sur l’actualité. En le publiant à une période de tensions et d’incertitudes, M. Tazerout entendait participer au Djihad du peuple algérien sous la forme d’un ijtihâd destiné à « décoloniser l’histoire » de tout le Maghreb. Cette « décolonisation de l’histoire » était souhaitée par M. C. Sahli à un moment où l’on s’attendait à un « désapprentissage de l’esprit spontané de domination[25] » par l’ex-colonisateur.
Pressentant l’importance qu’allaient avoir les revendications linguistiques dans le Maghreb post-colonial, il a abordé ces questions avec la clarté que permettaient son métier d’enseignant et les aboutissements de sa démarche démystificatrice.
Il conclut que les Berbères sont « unis par leur religion coranique, et différenciés seulement par l’usage du dialectal que les uns font de la langue arabe écrite de grande civilisation, et les autres de parlers berbères sans écriture connue. Les quelques fragments d’écriture kabyle découverts sur un rocher de Tifigha ne semblent avoir véhiculé jusqu’à ce jour que des chansons d’amour, d’ailleurs d’allure assez moderne, qui sont encore chantées dans la tribu des Ath Irathen et d’Adni. La première publication en caractère français avait été faite en 1867 par Hanoteau, la seconde en 1904 en doubles caractères français et arabes par Saïd Boulifa.
Quant aux essais de grammaire, tentés de tous côtés par les savants européens, on constate seulement qu’ils offrent de grandes analogies entre le kabyle du Djurdjura, le chaouiya de l’Aurès, le chleuh du Sud marocain et du Rif, le touareg du Sahara et le mozabite de Ghardaïa : mais aucun de ces dialectes ne s’écrit[26].
L’arabe littéraire qui s’écrit apparaît lui-même brimé et interdit, en fait, aussitôt après l’expulsion des Turcs d’Alger. Il n’apparaît plus lui aussi que sous des formes patoisantes, souvent mêlées de français, d’espagnol, d’italien, de maltais, de berbère et d’hébreu. Il survit à l’état pur coranique seulement dans la prière des laïcs chez eux ou à la mosquée, sans d’ailleurs s’étendre nulle part aux autres exercices du culte ou de la vie sociale, dans la mesure où les permettent les autorités colonisatrices. La seule langue littéraire officielle aujourd’hui en usage est donc le français, qui est baragouiné par une minorité d’autochtones l’ayant appris à l’école jusqu’au CEP, mais qui est ignoré totalement par la majorité des musulmans et qui n’est pleinement intelligible qu’à de rares privilégiés ayant pu fréquenter quelque Université française ».
Sans doute au moment où il rédigeait cette Histoire politique de l’Afrique du Nord, ce partisan de l’unité maghrébine a choisi de s’installer au Maroc où il aurait été conseiller au Palais royal[27].
Quand Rachid Benaïssa l’a rencontré peu de temps avant sa mort à Tanger en 1973, il lui a annoncé qu’il avait achevé une traduction du Coran en français. Au moment de prendre congé, il lui recommanda de « ne pas rougir d’être musulman ».
Cela montre l’ampleur de la métamorphose commencée par la répudiation des thèses assimilationnistes adoptées en 1914 et conduisant à la foi dans une Nation maghrébine ayant l’islam pour ciment.
Ce livre a été l’aboutissement d’une rupture comparable à celle du « Jeune ottoman » Ahmed Riza (1859-1930) qui, après avoir été un fervent comtiste laïcisant quand il vivait à Paris entre 1889 et 1908 a, sous l’effet du choc provoqué par le cynisme des grandes puissances pendant la Première Guerre mondiale, publié en 1922 une véritable défense et illustration de l’Islam intitulée La Faillite morale de la politique occidentale en Orient[28]. La qualification des crimes coloniaux par un intellectuel musulman algérien « modéré » mérite d’être proposée à la méditation des lecteurs à un moment où les nouvelles manipulations de l’histoire ne sont pas moins préoccupantes que celles auxquelles s’étaient livrés les scribes du colonialisme et leurs émules se réclamant indûment de l’histoire scientifique[29].
Cette réédition peut être utile compte tenu de la valeur de témoignage d’un essai où l’auteur fit le point de ses propres idées et convictions, et qui fut boycotté y compris par des anti-colonialistes. Elle se justifie également eu égard aux apports scientifiques de cette relecture d’une histoire qui fut trop sollicitée par ceux pour qui « l’Orient est une carrière », et l’écriture de l’histoire un instrument des politiques impériales.
Et il n’est pas superflu de noter la proximité des conclusions de la modeste recherche de M. Tazerout avec celles d’un historien impartial, spécialiste de l’Algérie contemporaine, mais qui a renouvelé récemment l’étude de l’histoire de l’Algérie antique[30].
On peut néanmoins regretter l’insuffisance de ses jugements — et de ses informations — sur la « piraterie maritime » à laquelle il a tendance à réduire toute l’histoire de la Régence d’Alger entre 1529 et 1830. Le renouvellement de cette histoire par Lemnouar Merrouche permet heureusement de corriger les excès de ces appréciations sans doute pardonnables à un chercheur qui était resté tributaire, sur ce point, de l’orientation des études historiques sur l’Algérie qui furent trop longtemps marquées par le « préjugé défavorable à l’égard des Turcs[31] ».
Pendant longtemps, M. Tazerout n’était connu que par les pages que j’ai pu lui consacrer, sous le titre « Le tirailleur devenu professeur » dans L’Islam et les musulmans en France, paru en 1987. Ce genre de portrait a beaucoup contribué à l’intérêt pour ce livre qui a été publié en pleine rentabilisation de la peur de tout l’Islam par des islamo-politistes plus utiles pour les politiques sécuritaires que pour la recherche islamologique. La présentation de cette réédition pourra contribuer à satisfaire la curiosité des nombreux lecteurs qui veulent en savoir plus sur une personnalité si attachante, mais restée trop longtemps méconnue. Quant à la relecture de l’Histoire politique de l’Afrique du Nord, elle montre, en cette période de célébration du cinquantenaire de l’indépendance, entre autres, comment les sentiments d’appartenance qui avaient été enfouis chez un grand intellectuel par un demi-siècle d’assimilationnisme furent transformés en patriotisme maghrébin par une répression dont la dureté ébranlait la foi dans le « modèle français d’intégration ».
Sadek Sellam
[1] Carton sur les prisonniers de guerre de la série 7N des archives du SHD (Service d’Histoire de la Défense) de Vincennes.
[2] Les Khalédiens de Paris, Abdelkader Hadj ‘Alî et ‘Alî al Hammami reprochaient à Bahloul ses bonnes relations avec Marius Moutet (ministre des Colonies du Cartel des Gauches), et ses illusions sur les possibilités de règlement des problèmes coloniaux par la social-démocratie.
[3] Indication fournie par l’érudit algérien de Paris Idir Ould Braham qui a eu accès au dossier de M. Tazerout au ministère de l’Éducation nationale.
[4] Publié chez Subervie à Rodez. C’est ce même éditeur qui publiera Histoire politique de l’Afrique du Nord et Manifeste contre le racisme.
[5] Paul Tubert : L’Algérie vivra française et heureuse. Intervention à l’Assemblée consultative (10 juillet 1945). Charlot. Alger. 1945. La lettre de Tazerout est reproduite dans la préface de cette brochure conservée dans la riche bibliothèque de Si Ahmed Taleb-Ibrahimi.
[6] « Le colonialisme n’est pas venu pour promouvoir » ; « il y a des peuples à civiliser ; mais il n’y a pas de peuples civilisateurs ; tout le drame est là » In Conditions de la Renaissance. Problème d’une civilisation. Nahda. Alger. 1949.
[7] Dans un article remarqué des Cahiers internationaux de Sociologie du début des années 50.
[8] Qui « se ramène tout uniment au fait que le gouvernement ne veut pas rendre des comptes ». C. A. Julien : L’Afrique du Nord en marche. Julliard. Paris. 1972. p. 344.
[9] C’était au moment de la création des zones interdites dont les habitations devaient être dynamitées ou rasées au bulldozer. Quand l’acheminement de tous ces matériels vers les villages de haute montagne s’avérait difficile, c’est l’aviation qui se chargeait de cette œuvre « civilisatrice » provoquant plus de ravages que les fameux « tirs à priori » de l’artillerie, dont les victimes n’étaient comptabilisées nulle part. En février 1958, un certain lieutenant Schmitt adressait une demande manuscrite réclamant des tonnes de TNT supplémentaires et des bulldozers pour vider complètement les montagnes de Bouzegza de leurs habitants. C’est ce « héros » que le président F. Mitterrand nommera chef d’État-Major, sans doute pour montrer que la République ne tient pas rigueur pour les crimes contre l’humanité commis hors d’Europe…
[10] Dans une note au Deuxième Bureau datée de 1955.
[11] Entretien avec le regretté Gilbert Delanoue. Il s’agissait d’utiliser des arabisants pour améliorer le renseignement sur les activités des représentants du GPRA et des nombreux membres de l’UGEMA qui étudiaient à Damas.
[12] C. A. Julien : L’Afrique du Nord en marche. Julliard. Paris. 1972. p. 343.
[13] Cité par E. Saïd dans L’Orientalisme. Seuil. 1994. p. 251.
[14] Ibid., p.369.
[15] C. R. Ageron : Histoire de l’Algérie contemporaine. Que sais-je. PUF. Paris. 1966. pp. 65-67
[16] C. R. Ageron : Histoire de l’Algérie contemporaine. Tome II. PUF. Paris. 1979. Chapitre « la Politique berbère », pp. 137-152.
[17] Ibid.
[18] Selon les traditions kabyles, les Berbères étaient originaires de Palestine, sauf trois de leurs tribus qui seraient venues de Perse. Selon Ageron, beaucoup de Kabyles se voulaient même d’origine arabe. Dans un article consacré aux « Kbaïles du Djurdjura », paru dans la Revue de Paris en 1871, Ismaïl Urbain estime que la tribu des Zouaouas est arrivée du Sud tunisien dans le Djurdjura au début du XVIe siècle. Quant à Salah Ben Mehenna, il croyait savoir que des tribus berbères entières qui avaient conservé leur langue en Andalousie se sont installées au voisinage des ports de la côte kabyle après la chute de Grenade en 1492.
Voir Slimane Essayd : Salah Ben Méhenna al qaçantini. Hayatouhou. Tourathouhou. Dar al Baath. Constantine. 1983. Je remercie l’érudit Lahcène Benadjila de m’avoir offert un exemplaire de ce livre épuisé.
[19] Ibid. Au projet d’unification des deux rives de la Méditerranée sous la bannière de la latinité chrétienne, Abderrahman Belhaffaf opposa au début des années 30 la thèse de l’origine arabe de certaines tribus… gauloises ! Le manuscrit jamais édité de l’érudit algérois est cité dans l’ouvrage inédit d’Augustin Berque : Le Néo-wahabisme. Alger. 1932.
[20] Selon un ambitieux projet présenté à Napoléon III par un déserteur de l’armée britannique des Indes, Robert Palgrave. Il s’agissait de reprendre le rêve de Bonaparte, en utilisant les forces hostiles au calife d’Istanbul, comme le wahhabisme, pour se tailler un empire colonial sur les anciennes possessions de l’Empire ottoman. Palgrave jugeait superficiel le sentiment religieux des bédouins de cette partie de l’Arabie et croyait possible leur christianisation par une alliance entre les Pères blancs, les militaires et les diplomates.
[21] Il y avait 6 délégués kabyles pour 700 000 habitants. Les « Arabes » disposaient de 15 pour 3 300 000 habitants. Les « démocrates kabyles » du Djurdjura (372 000) eurent à eux seuls 4 délégués, et se virent dotés d’un système électoral archaïsant inventé par Sabatier : les délégués financiers devaient être élus par « les chefs de groupe dits kharrouba ».
Les chefs de kharrouba ou dhamen avaient disparu de Petite Kabylie. La préfecture se contenta de désigner comme électeurs les dhamen nommés par les administrateurs et dans la Petite Kabylie les 93 adjoints indigènes. Les 3000 électeurs de Grande Kabylie étaient désignés par l’administration. Cela revenait à conditionner les élections en amont, alors que d’autres, et pas seulement sous Naegelen, ne se gêneront pas à bourrer les urnes.
Par ailleurs, afin de faciliter le mariage des Européens avec des jeunes femmes kabyles, Sabatier proposa l’interdiction du tatouage facial des filles; il fit ouvrir des écoles pour jeunes orphelines kabyles et demanda un décret autorisant les Kabyles à franciser leurs prénoms et noms patronymiques comme la loi de mars 1882 leur imposait. Mais il essuya un refus du gouverneur Tirman. Il n’est pas inutile de rappeler ici tous les prolongements des politiques inspirées par le « mythe kabyle », à un moment où l’invocation d’un « royaume juif berbère », supposé avoir existé au sud du Maroc, sert surtout à établir des passerelles entre un certain radicalisme berbériste excentrique et des courants sionistes qui ne se contentent pas de la reconnaissance d’Israël dans ses frontières actuelles.
[22] Au Maroc, Lyautey adhérait aux thèses de Sabatier bien avant la promulgation du fameux « Dahir berbère » de 1930. Dès 1921, le futur maréchal envisageait en effet une désislamisation des Berbères par des restrictions apportées à l’enseignement du Coran qu’il craignait en raison de la diffusion de la langue arabe qu’assurait cet enseignement dans les régions berbérophones.
[23] C. R. Ageron, op. cit.
[24] Cité par E. Saïd, op. cit.
[25] Raymond Williams cité par E. Saïd, op. cit.
[26] Après avoir dirigé le premier établissement privé berbère ouvert au Maroc juste après l’indépendance, le chercheur du CNRS Ahmed Moattassime, dans ses études des années 80 et 90 sur l’enseignement des langues au Maghreb, souligne les grandes difficultés d’enseignement des parlers berbères.
[27] Entretien avec Idir Ould Braham.
[28] Réédité par Alam el Afkar à Alger, en 2009, avec une préface de Sadek Sellam.
[29] Malgré l’abrogation des articles à problèmes de la loi du 23 février 2005 vantant les « bienfaits de la colonisation », celle-ci est entrée en application lors de la création de la Fondation pour l’étude de l’histoire de la colonisation. La nomination à sa tête d’un historien révisionniste de l’économie coloniale est un signe qui ne trompe pas. Cet historien-idéologue trouve encore « normal » les enfumades des grottes des Ouled Riah dans le Dahra par le colonel Pélissier en 1845, prétend que l’économie française n’aurait jamais eu besoin de travailleurs immigrés maghrébins qui auraient été admis à exercer en France par générosité. Il a apporté une caution pseudo-savante aux débats « l’identité nationale » à finalité électorale et a prêté à Delouvrier, après sa mort bien sûr, des propos dont l’historicité est sujette à caution. Cet ancien des « Jeunesses communistes » semble accepter de jouer au Lyssenko de l’histoire française de l’Algérie, sans doute pour obtenir des avantages comparables à ceux que convoitent les admirateurs de R. Montagne qui assument de nouvelles formes de collusion entre « le Sociologue et le Commissaire ». Cette nomination est aussi provocatrice que le projet de 2002 qui aurait confié le dossier des crimes coloniaux à un réserviste de l’armée…israélienne.
[30] « …pendant la phase coloniale, les fantasmes français représentaient sans hésiter l’Empire romain d’Afrique, en continuité civilisationnelle, comme un prestigieux précurseur de l’Algérie française. » G. Meynier : L’Algérie des origines, de la préhistoire à l’avènement de l’Islam. La Découverte. 2007. p. 9.
[31] Roger Le Tourneau : compte-rendu du livre de P. Boyer (L’Algérie médiane). Revue africaine. Numéro 104. 1960. p. 457.